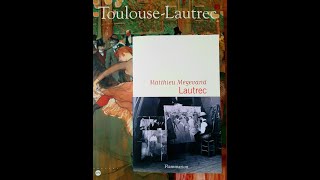Après la lecture d'Assassins !, j'ai eu très envie de rencontrer Jean-Paul Delfino, dont j'avais déjà lu plusieurs de ses romans sur le Brésil, pour connaître ce qui l'avait amené à s'intéresser à la mort de Zola.
Il a immédiatement accepté et après avoir apprécié un écrivain talentueux, j'ai fait connaissance avec un homme chaleureux, attentif aux autres, à la parole franche, vive, imagée et sans ambages. Bref, ce fut une rencontre formidable !
 |
©
|
On vous connaît pour votre univers très romanesque et notamment pour vos romans sur le Brésil. Pourquoi vous être intéressé à un personnage réel et singulièrement à Zola ?
On écrit des livres pour plusieurs raisons. Généralement, quand on a une idée et qu’on veut en faire de la littérature, ce n’est pas ce qu’on fait de mieux. Moi je préfère quand les sujets viennent vous sauter à la gueule.
Et concernant Zola, c’est très simple : je suis passé directement de Oui-Oui et San Antonio, grosso modo, à Germinal, que mon grand-père a eu la riche idée de m’offrir quand j’avais 11-12 ans. Et comme il était mineur de fond - il a passé quarante-trois ans de sa vie à 500 mètres sous terre - quand j’ai commencé à lire ce livre, je me suis aperçu que j’allais peut-être commencer à comprendre ce qu’était la littérature et à quoi ça servait. Je ne sais pas si vous avez vu le formidable film de Claude Berri ; prenez la scène où Depardieu se lave dans un baquet en rentrant de la mine, mon grand-père c’était ça. Mes grands-parents n’avaient ni l’eau ni l’électricité. Donc, voilà, pour moi Zola ça avait vraiment du sens.
Après, j’avais en tête l’histoire de ce mensonge institutionnel, Zola mort par accident. Je n’arrive pas y croire une seconde. Mais entre le moment où on a envie d’écrire sur un sujet et le moment où arrive l’instant I, ça on ne le maîtrise pas...
"Zola mort par accident.
Je n’arrive pas y croire une seconde."
En fait, j’entassais des notes sur cette affaire depuis un an et demi. J’ai épluché sur Gallica toute la PQR [presse quotidienne régionale] et la presse nationale de 1890 à 1905. Et un samedi matin, un car de Japonais s’arrête sous ma fenêtre - j’habite Aix-en-Provence, en bas du cours Mirabeau - et je les vois sortir et se mettre à mitrailler la façade de mon immeuble - qui n’a strictement rien de rare, ce n’est pas un immeuble classé. Je me demandais vraiment ce qu’ils foutaient là… Le samedi d’après, même chose, le samedi suivant, pareil. Et là, j’en ai parlé à ma mère qui est allée à la mairie, au cadastre, à l’office du tourisme, partout... et elle est revenue avec un sourire jusqu’aux oreilles ! On était dans ma salle à manger et elle me dit : « Voilà, tu traces un trait de là à là : la partie gauche, c’est là que Zola, sa mère et son grand-père ont vécu, avant que Zola parte vivre à Paris. » Inutile de vous dire que pour elle je suis juste la réincarnation de Zola ! Bien évidemment, en tant qu’ancien journaliste j’ai vérifié les délires maternels, et elle avait raison ! J’habite chez Zola !
Donc ça faisait beaucoup de points qui me disaient de me jeter là-dedans et d’écrire.
Comme vous, j’ai toujours eu en tête l’idée que Zola avait été assassiné, mais aussi que cela n’avait jamais été prouvé. La lumière a-t-elle été faite ? A vous lire, le meurtre ne fait aucun doute. Sur quels éléments vous êtes-vous appuyé ? Quelle a été votre démarche ?
 |
Or, il y avait ce Jean Bedel qui, en 1953, avait sorti l’histoire de Buronfosse. Il était journaliste à Libération et, sur un quai de gare, il avait rencontré un vieux pharmacien à la retraite avec lequel il s’était mis à discuter. Il lui a dit qu’il avait connu un nommé Buronfosse qui, avant de mourir, lui avait confié quelque chose qu’il avait à son tour envie de dire à un journaliste tel que lui : Zola était mort assassiné, et c’est Henri Buronfosse qui était allé boucher sa cheminée. Mais Bedel n’avait pas pu aller beaucoup plus loin à l’époque. D’autant que le pharmacien en question est mort deux ou trois jours après, comme si le fait de s’être libéré de ce secret l’avait précipité dans l’au-delà… Et ça en est resté là.
Après, il y a les Henri Mitterand, les Henri Troyat, des universitaires qui ont écrit des sommes de savoir formidables et que j’ai lues, bien évidemment. Mais moi, ce qui m’intéressait, c’était de savoir qui avait armé le bras de Buronfosse.
"Au moment de mourir,
à quoi Zola a-t-il pensé ?"
à quoi Zola a-t-il pensé ?"
Et puis à côté de la question de savoir qui a tué Zola, il y a celle de sa mort en elle-même. Assassiné ou pas, j’ai tranché pour mon univers à moi. Personne ne parle jamais de la façon dont il est mort, c’est-à-dire les gaz méphitiques, le monoxyde de carbone qui vous réduisent à quelque chose de pas très reluisant à regarder et à sentir. Et là, j’ai fait une description très naturaliste de sa mort. Quand on meurt par asphyxie, le corps se délite complètement, mais le cerveau, lui, reste en parfait état de marche. Et donc, pour moi, la question fondamentale de ce roman, c’est celle-là : au moment de mourir, à quoi Zola a-t-il pensé ? C’est en ça que je fais œuvre de littérature, et non de journalisme. Mon Zola à moi est profondément humain, comme sa littérature est pétrie d’humanité. Alors j’ai imaginé...
Je parle de ses amours mortes, de ses rêves... Et quand j’évoque l’affaire Dreyfus, c’est pour parler de sa frustration absolue, de sa déception... Le repas qu’il a partagé avec Dreyfus, je ne l’ai pas inventé, c’est ça qui est terrible. Et c’est ça qui pour moi peut être intéressant : mêler à la fois la peinture d’une époque, d’une société, qui est d’une violence absolue, et Zola qui est en train de mourir et qui réfléchit.
Effectivement, votre dispositif narratif permet de revenir sur la personnalité de Zola au-delà du rôle qu’il a joué dans l’affaire Dreyfus. On découvre ainsi l’homme, ses fêlures, sa soif de reconnaissance. En mettant en perspective les attaques dont il a fait l’objet en tant qu’écrivain - un écrivain d’origine étrangère qui prétendait révolutionner la littérature française - avec celles dont il est victime à la suite de l’affaire Dreyfus, vous montrez qu’il était doublement « coupable » aux yeux des nationalistes...
Oui, j’ai essayé d’alterner le doux et l’amer. Et c’est vrai que les chapitres consacrés à ceux qui ont fomenté l’attentat et le meurtre de Zola sont d’une violence extrême. Dans le chapitre 2, par exemple, il y a toute la narration de la manifestation dans les locaux de « La libre parole » et c’est d’une violence absolue. Il y a une violence de salon aussi. Quand je parle de Gyp, notamment, les choses sont dites à mots feutrés.
Mais à côté de ça, il y a aussi le soleil d’Aix-en-Provence, tout ce qui fait qu’on aime la vie. A la fin les deux histoires se rejoignent…
Mais à côté de ça, il y a aussi le soleil d’Aix-en-Provence, tout ce qui fait qu’on aime la vie. A la fin les deux histoires se rejoignent…
Et est-ce qu’écrire cette histoire-là aujourd’hui était aussi une manière de tendre un miroir à notre société actuelle ?
Dans l’acte déclencheur d’écrire ce livre, non. Mais le livre a pas mal de presse et à chaque fois que je reçois des articles, ou même dans le milieu des blogueurs et des blogueuses, il y a toujours un moment où il est dit que ce roman est d’une « actualité troublante ». Hélas oui. La littérature sert aussi à raconter et à rappeler de temps en temps ce que l’Histoire avec un H majuscule a mis sous le tapis. Donc en ce sens, oui, bien sûr, c’est un acte militant.
Alors justement, est-ce que vous pensez que l’écrivain doit s’engager ? Zola, c’est LA figure de l’écrivain engagé par excellence. J’ai regardé un peu ce que vous disiez sur les réseaux sociaux et lorsque Bolsonaro a été élu au Brésil vous avez ouvertement affiché votre opposition...
Oui, et d’ailleurs je suis maintenant persona non gratta au Brésil. Ça se paye...
Mais est-ce que l’écrivain doit être engagé ? Non, pas au sens d’un engagement politique. Mais quand le sujet le demande, oui : si je m’étais contenté de faire un livre juste avec les chapitres impairs, j’aurais raconté la fin de Zola en disant que peut-être ce n’était pas un accident, mais qu’on n’en était pas sûr. C’est de la littérature tiède, ça, c’est un cadavre, ça n’a pas d’intérêt !
Quand on est littérateur et qu’on a la chance d’avoir un peu de lecteurs, on a une espèce d’amplificateur à disposition et on est libre de s’en servir ou pas. Il y en a qui claironnent tout le temps dedans - en estimant peut-être que ça peut remplacer leur manque de talent... Hurler au loup, crier constamment à l’injustice, non. Il faut que ça ait du sens dans le livre qu’on est en train d’écrire.
Il y a 35 ans, Caetano Veloso, qui est sans doute, avec Chico Buarque le plus grand musicien et poète vivant au Brésil, me racontait ce qu’avait été la chanson brésilienne en 1964, quand la dictature avait pris le pouvoir : c’était une chanson faite par des intellectuels, des universitaires, qui ne disaient que des choses formidables, qu’il faut lutter contre la dictature. Mais ça a donné des chansons totalement pourries ! Ce n’est pas avec des bons sentiments ou des bonnes idées qu’on fait de la bonne littérature.
Ce qui est intéressant chez un écrivain, c’est sa « petite musique ». Personnellement, je pense qu’on se fout complètement que Voltaire, par exemple, ait été pour ou contre dans l’affaire Calas. Ce qui est important, c’est ce qu’il a laissé, c’est son style avant tout. Un style qui se reconnaît, qu’on l’aime ou qu'on ne l'aime pas.
A propos de la « musique de l’écrivain », vous avez écrit tout un cycle de romans sur le Brésil, qui s’étendait sur plusieurs générations, qui racontait l’histoire de ce pays et en faisait une peinture sociale. En cela, on peut voir une analogie avec l’œuvre de Zola. Est-ce que la « musique » de Zola a eu une influence sur votre propre travail d’écrivain ?
Inconsciemment, sans doute. Mais, très modestement, j’essaie d’écrire ma propre histoire. Zola, c’est tellement énorme, c’est tellement gigantesque qu’il faudrait être fou pour se dire « je suis le nouveau Zola ». Non, je suis juste le petit Delfino et je n’ai pas de maître en littérature ! Mais j’ai des phares. Et Zola éclaire d’une manière différente des autres, comme Cendrars, comme Voltaire...
Vous citez des écrivains engagés, ce n’est pas un hasard...
Non. Parce que je suis aussi le fils de gens qui étaient syndiqués et politiquement ancrés ; j’ai été élevé dans la haine du capitalisme, dans l’adoration du marxisme, du léninisme. Dans ma famille, ils étaient tous encartés au Parti. Moi, non. J’ai toujours refusé de suivre un chef. Mais on est aussi le fruit de son éducation, et Zola a fait partie de la mienne, comme Voltaire.
Mais je ne lorgne pas sur une affaire qui ferait ma renommée. Moi, je suis mon petit chemin, je suis un raconteur d’histoires. Il faut se borner à ce qu’on sait faire et, de temps en temps, quand on a la possibilité de pousser des coups de gueule et qu’on est écrivain, il faut le faire. Sinon, on manque à sa propre parole...
Mille mercis à Jean-Paul pour ce formidable échange, ponctué de rires
et empreint de chaleur !