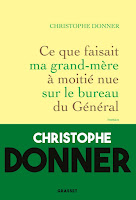Aslak Nore
Le Bruit du Monde, 2023
Traduit du norvégien par Loup-Maëlle Besançon
Oslo, 2015. Vera Lind, vénérable aïeule de l’une des familles les plus fortunées de Norvège se donne la mort. Non sans avoir préalablement fait disparaître son testament.
Au sein de la famille, la tension monte. Entre les deux branches, les relations n’étaient déjà pas des plus chaleureuses. Issues des deux mariages successifs du Grand Thor, qui trouva la mort dans un naufrage au début de la Seconde Guerre mondiale, elles n’ont de commun que le nom de Falck. L’une, incarnée par le petit-fils Hans, installée sur la côte ouest, mène une existence bohème. Si Hans est un médecin connu et reconnu pour son engagement humanitaire au Moyen-Orient, il brille aussi par ses déclarations tendance gauchisante et le peu d’attention qu’il porte à sa descendance.
L’autre, issue du remariage de Thor avec Véra qui donna naissance à Olav, n’a cessé de faire fructifier le patrimoine familial, patrimoine financier, certes, mais aussi culturel, grâce à la création de la fondation SAGA. Centre d’archives, celle-ci a en effet pour mission de documenter et diffuser l’histoire de la résistance norvégienne durant la guerre, dont Thor passe pour avoir été l’un des pionniers.
Comme vous vous en doutez, la famille Falck n’est pas exempte de secrets soigneusement enfouis, de rancoeurs plus ou moins contenues ni surtout de conflits d’intérêts. Or certaines révélations auraient été au coeur d’un manuscrit que Vera, écrivaine jouissant alors d’une petite notoriété, avait écrit à l’aube des années 70. Renfermant des informations sensibles, celui-ci fut saisi par les Renseignements généraux interdisant sa publication. Si certains membres de la famille ont l’intuition qu’il est de leur intérêt que ce manuscrit ne remonte jamais à la surface, d’autres ne songent qu’à en connaître la teneur…
En dépit des mises en garde de son père Olav, Sacha, très attachée à sa grand-mère, veut comprendre les raisons de son suicide. C’est donc elle qui va mener l’enquête, au risque de déclencher une véritable bombe à retardement…
Aslak Nore nous entraîne dans un récit haletant aux multiples facettes qui nous conduit, entre les années 40 et nos jours, d’Oslo à Bergen, du Liban au Kurdistan, pour nous révéler les paradoxes d’une société fondée sur les valeurs de liberté et de tolérance. C’est passionnant et très instructif pour qui connaît si mal, comme c’est mon cas, l’histoire et la culture de ce pays.
Mais la réussite de ce roman tient surtout à la richesse de son intrigue dont l'auteur entremêle les fils avec une maestria qui trouve son apothéose dans la toute dernière phrase du roman. Le rythme ne souffre aucun temps mort, les relations que chacun des membres de la famille entretient avec les autres sont observées avec une grande acuité et l’on dévore les pages pour connaître le fin mot de l’histoire. Certes, on butte bien sur quelques noms à rallonge d'organismes norvégiens renfermant un nombre totalement extravagant de consonnes. Mais, je vous rassure, ils restent peu nombreux. Et puis ils offrent l’avantage de ralentir un tout petit peu la lecture, permettant ainsi de ne pas arriver trop rapidement au terme de ce trépidant roman !